 Selon le Global Competitiveness Report 2015-2016, la France se trouve au 22e rang. Score assez bon si on pense d’être à coté de l’Autriche et d’Australie, mais un peu moins bon si on pense au rang 4 de l’Allemagne et 10 des Royaume Unis.
Selon le Global Competitiveness Report 2015-2016, la France se trouve au 22e rang. Score assez bon si on pense d’être à coté de l’Autriche et d’Australie, mais un peu moins bon si on pense au rang 4 de l’Allemagne et 10 des Royaume Unis.
En regardant de près sur les dimensions qui tirent la France vers le bas on trouve la « Qualité de relation entre les Employeurs et les Salariés ». La France est au 116e rang, relation de l’état de guerre virtuelle qui nous place derrière, probablement Afghanistan et d’autres pays en état de guère réelle.
La chronique de Philippe d’Iribarne ci-dessous explique les raisons de cet état de relation employeurs-salariés en pointant notre héritage étatique protecteur, paternaliste et infantilisant (« Allons enfants de la patrie »…). La question si cette relation peut avoir une nature radicalement différente en France n’est pas l’objet de sa chronique. Toutefois, des centaines d’entreprises libérées en France démontrent qu’une telle relation n’est pas une malédiction et que les acteurs économiques Français peuvent–en adultes–faire de leur entreprise une communauté du destin et du bien communs, dont les éléments essentiels sont la dignité et la liberté.
Échec de la réforme du Code du travail : les raisons de l’exception française
Philippe d’Iribarne*
Le Figaro 15 mars 2016
Une fois encore, un projet de réforme inspiré par le souci de rendre plus fluide le fonctionnement du marché du travail est dénoncé comme portant atteinte à la dignité des travailleurs. Les commentaires des adversaires sont sans appel. « Le patron, il te licencie comme il veut » ; « Tu peux être renvoyé comme ça » « Cette loi crée des parias dans la société française » . Dans ces propos, il n’est pas question du fonctionnement d’un marché où le travail, considéré comme un bien de production, se négocie entre partenaires, mais d’un rapport d’autorité à travers lequel un « patron » soumet à sa volonté ceux qui n’ont qu’à obéir. Pourquoi les Français sont-ils si réticents face à une flexibilité du travail qui paraît si naturelle dans d’autres pays qui n’ont pourtant rien à envier à la France en matière de respect des droits de l’homme et d’attachement à la dignité humaine ?
Dans aucun pays démocratique, de part et d’autre de l’Atlantique, il n’a été facile de concilier l’idéal du citoyen autonome et la condition de travailleur salarié, exerçant son activité sous l’autorité d’un autre. Partout, on s’est demandé, quand on est sorti de l’Ancien Régime, si celui qui dépendait pouvait être un vrai citoyen, suffisamment autonome pour participer aux décisions publiques. Partout, cette interrogation a conduit à l’élaboration, dans le droit et dans les moeurs, de relations entre employeurs et salariés limitant la dépendance des seconds à l’égard des premiers. Mais ces relations ont pris des formes sensiblement différentes d’un pays à l’autre, en rapport avec l’image de l’homme libre qui prévalait dans chacun d’eux. Dans le monde anglo-saxon, le salarié a été vu comme un entrepreneur de lui-même, gardant son autonomie au sein de rapports temporaires avec un employeur considéré comme un client, dans un cadre légal lui permettant de négocier à armes égales. Dans le monde germanique, le salarié a été vu comme membre d’une communauté unissant les employeurs à des employés ayant voix au chapitre dans des décisions communes. En France, le salarié a été vu comme pourvu d’un statut, assimilé autant que faire se peut à celui qui détient une charge, protégé par celle-ci contre le bon plaisir de son employeur.
Ces différences de vision du travailleur possédant la dignité du citoyen conduisent à des façons bien différentes de gérer la flexibilité du travail. Dans l’univers anglo-saxon, celle-ci est naturelle ; le contrat de travail n’est qu’une sorte de contrat commercial par nature précaire. Ce n’est pas que l’employeur fasse ce qu’il veut. Nombre de contrats d’entreprise ou de règlements intérieurs sont très contraignants quant à l’ordre des départs (et des éventuels retours ultérieurs) en cas de réduction d’activité. Mais il va de soi que l’employeur a besoin d’autant plus de travailleurs que la demande qui s’adresse à son entreprise est plus forte. En Allemagne, quand le travail manque, on n’exclut pas sans réticence ceux qui font partie de la communauté. Mais ceux qui travaillent temporairement pour l’entreprise, sans vraiment faire partie de celle-ci, sont invités sans problème à exercer leur activité ailleurs. Et il paraît normal que, si la demande baisse, tous s’accordent pour travailler moins en gagnant moins.
La France est encore dans une autre logique. Si l’employeur peut mettre fin sans contrainte majeure à l’appartenance d’un salarié à l’entreprise, celui-ci ne dispose plus d’un statut – d’une charge – qui bénéficie de la garantie protectrice de l’État. Si les accords d’entreprise l’emportent sur l’ordre public, chacun dépend de ce qui se trame dans la maison de son maître. Selon cette conception des rapports sociaux, la condition du salarié soumis au libéralisme économique rejoint celle du domestique du temps de l’Ancien Régime et il perd la dignité d’homme libre.
On voit là une source majeure des difficultés françaises. Au nom d’un rêve de mondialisation heureuse, apportant le progrès social en s’appuyant sur le progrès économique, la France s’est engagée avec enthousiasme dans une économie largement ouverte aux grands vents d’une concurrence planétaire. Comment imaginer dès lors que la précarité de la situation des entreprises, dont les clients risquent à tout moment de passer à la concurrence, pourrait ne pas se répercuter sur la situation des travailleurs ? C’est en vertu du caractère inévitable de ce lien que le gouvernement cherche à rendre le marché du travail plus flexible. Or, étant donné la conception française de la dignité des travailleurs, une telle flexibilité est vécue comme insupportable.
Il y a en fait bien longtemps que cette tension entre une logique économique et une logique sociale saute aux yeux. Mais encore faut-il accepter de la voir. Pour s’en dispenser, il suffit d’éviter de considérer la situation de l’entreprise, prise en tenaille entre la liberté qu’ont ses clients de la laisser choir et les obligations où elle se trouve à l’égard de ses salariés. Pour les critiques actuels de la réforme, l’entreprise n’existe pas. Il y a seulement des « patrons » qu’il s’agit de contraindre.
Peut-on sortir d’un tel déni et trouver une forme française de flexibilité compatible avec une vision française de la dignité des travailleurs ? Si c’est impossible, c’est le projet même d’intégration de la France dans une mondialisation heureuse qui fait question.
* Directeur de recherches au CNRS, auteur de « L’Étrangeté française » (Seuil, 2006). Dernier ouvrage paru : « L’Islam devant la démocratie » (Gallimard, 2013).
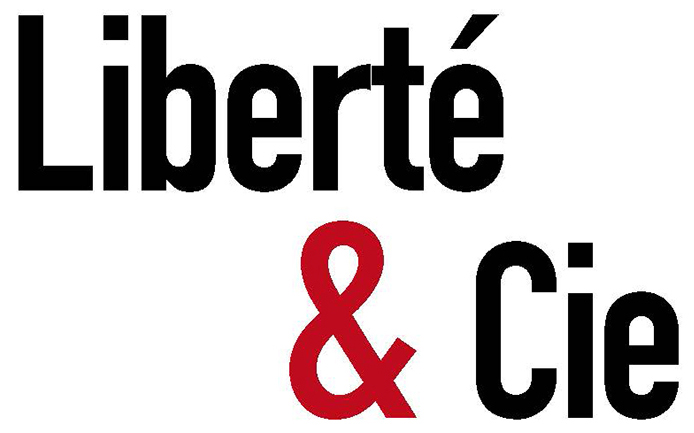







Ce que vous décrivez est juste. Peut être que si on avait pas rabâché aux Français que la France est un pays de valeurs, de liberté, de fraternité, d’égalité, de respect, etc les salariés appréhenderaient la situation différemment. Cependant, étant donné les commentaires de certains hommes politiques (les Français ont des poils dans la main) et les réformes de Pole Emploi (plus de contrôles, évocation d’une dégressivité des allocations, etc), le chômeur est considéré comme un paria qui vit aux crochets de la société, de ceux qui travaillent… du coup, un citoyen sans travail perd sa dignité… et sa liberté d’agir puisque dans une société de consommation, l’argent est roi.
Je ne crois pas que la France ait jamais cru à une mondialisation libérale heureuse. Elle n’y est entrée qu’à reculons, sauf chez certaines de ses élites. Même pire, une partie du pays a vécu ce moment comme une réelle déchirure, une capitulation en rase campagne semblable au traumatisme de 1940. Le « tournant de la rigueur » de 1983, c’est la « drôle de guerre » de 40 pour le peuple de gauche.
Au-delà de cette hostilité de fond, se rajoutent des fractures sociales entre le peuple et ses élites. Une partie importante de la population ne croit tout simplement pas que les entreprises ne peuvent pas « faire mieux » sur le plan des performances économiques, sans avoir besoin de réduire les salaires ou les droits sociaux. Elle considère qu’il y a encore des marges de manœuvre au sommet de la pyramide avant de devoir aller taper en-dessous. Et que le système économique n’est pas une donnée de la nature. Mais le résultat de choix politiques.
D’où la tendance à rejeter les fameuses « réformes », d’où la tendance aux rapports conflictuels entre salariés et employeurs. Pas par conservatisme, mais par défiance et volontarisme politique. Les français sont nombreux à ne pas croire au fameux slogan « TINA » (There is no alternative). Ils pensent qu’il y a bien une autre alternative qui n’est pas dans le rejet de la mondialisation. Mais dans une mondialisation domestiquée. Et que si la France a encore un rôle à jouer dans le monde, c’est bien de défendre cette idée, même isolée. L’exemple de la Révolution n’est sans doute pas étranger à cette attitude un peu rebelle et idéaliste.